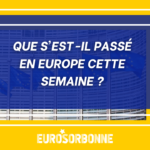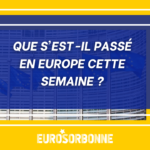La Pologne et la sécurité européenne : un nouveau souffle ?
Article écrit par Michel Santamaria
« Nous voulons que l’Union européenne (UE) ait son mot à dire dans toutes les affaires internationales importantes, et cela ne sera pas possible sans le renforcement de notre position, sans le renforcement de notre industrie de défense et de nos capacités de défense ». Ces mots, prononcés par Paweł Zalewski, secrétaire d’État polonais à la Défense lors d’une interview accordée à Euractiv illustrent la vision stratégique que la Pologne veut amener au sein de l’Union européenne.
La Guerre en Ukraine, principale menace pour la Pologne
La Pologne, actuellement à la tête de la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, fait de la sécurité l’objectif prioritaire de son agenda pour les six prochains mois. La guerre en Ukraine, est perçue comme la menace principale aux frontières polonaise et dicte depuis un temps la participation polonaise au sein de l’UE. En juillet dernier, elle avait triplé ses effectifs militaires aux frontières avec la Russie et la Biélorussie. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a eu pour conséquence que la Pologne augmente la part de son budget alloué à la défense (environ 4%) avec l’objectif de devenir la « première armée d’Europe » avant 2035. Maintenant, elle vise à transmettre l’enjeu sécuritaire au sein de l’UE.
Comment financer la défense européenne ?
La Défense est un sujet qui coûte très cher, et la Pologne en est au courant. Selon plusieurs sources, environ 500 milliards d’euros sont nécessaires pour augmenter la production et couvrir les besoins de défense. Radosław Sikorski, ministre des Affaires étrangères de la Pologne a émis l’idée de la création d’une banque de réarmement, dont le but serait de collecter de l’argent pour « augmenter ses capacités de défense et dissuader l’agression russe ». Ce serait une idée calquée sur le modèle de la Banque européenne de reconstruction et de développement créée pour promouvoir le développement des anciennes nations du bloc soviétique.
Un autre exemple serait dans l’usage du programme industriel européen EDIP, la Pologne souhaite pouvoir acheter des biens à des entreprises étrangères, afin d’allier renforcement du projet de défense européen avec les nécessités de réarmement rapide imposé par la Guerre en Ukraine. Pour y arriver il faudra pacter avec les autres pays, et en particulier la France qui semble avoir une idée différente de l’usage du programme industriel européen. En effet, les français veulent utiliser ce programme pour développer en premier lieu les entreprises européennes, alors d’autres pays souhaitent pouvoir l’utiliser pour acheter à des pays extérieurs. Encore un fois, au sein de l’Union européenne, il semble que l’éternel débat sur l’orientation de la défense européenne resurgisse, avec les Français poussant vers une autonomie européenne, et les autres États membres pour plus de coopération avec les Américains.
Annonces de Donald Trump sur Gaza : réactions internationales et questions en suspens
Article écrit par Michel Santamaria

Le mardi 04 février 2025, le président américain Donald Trump a fait une annonce qui a bouleversé la communauté internationale. Lors d’une conférence de presse, accompagné par Benjamin Netanyahu qui était en visite officielle à Washington, le président des États-Unis à déclaré que « Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza ». Cette annonce a pris de court les politiques américains et les dirigeants du monde entier.
Une condamnation quasi unanime
L’annonce surprenante et choquante a déchaîné une vague de réaction dans le monde entier. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite à déclaré : « L’Arabie saoudite poursuivra ses efforts inlassables pour établir un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, et n’établira pas de relations diplomatiques avec Israël sans cela ».
L’Égypte, la Jordanie et l’Arabie Saoudite ont également rejeté la proposition de Donald Trump de déplacer les habitants de Gaza vers les pays voisins. Les Australiens et les Français, ont également rejeté la déclaration américaine et ont réitéré leur soutien envers une solution à deux États.
En France encore, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, a réagi en rappellent que c’est une « diplomatie de choc » qui est une faute « puisqu’il s’agit d’une violation du droit international, une violation du droit des peuples, avec des transferts forcés de population, et d’une profonde injustice concertant l’avenir du peuple palestinien ». Les dirigeants de pays européens ont condamné en masse les propos, mais aucune déclaration commune n’a été faite par l’union, seulement une réaction minime qui rappelle le soutien de l’UE à la solution aux deux États.
Qu’en est-il de l’Union européenne ?
Invité sur le plateau de Quotidien, l’ancien ambassadeur de France en Israël et aux États Unis Gérard Araud a rappelé le manque de sérieux des propos de Donald Trump qui a fait de ces sorties médiatiques un amusement. Néanmoins, l’ancien ambassadeur rappelle que les propos du président américain posent une question importante et dont les dirigeants du monde évitent de parler : celle de l’aide à la reconstruction de Gaza.
En effet, les conditions sont les suivantes : 2 millions de civils à la rue au sein d’un territoire totalement détruit, miné, sans aucun service public. Autrement dit, les conditions de vie des palestinien n’est plus humain et continuera de s’aggraver sans aucune intervention ni aide extérieur. La question de la reconstruction est donc urgente. Pourtant, si les paroles de Donald Trump ont été largement condamnées par tous les dirigeants possibles, personne n’ose la poser.. L’avenir de Gaza reste une question ouverte, mais la période de cessez-le-feu et le retour des Palestiniens chez eux pose des questions que de simples condamnations ne semblent pas en mesure de résoudre. Comme l’écrit Gérard Araud, « Trump, reconnaissons-le, pose une question légitime dont le reste de la communauté internationale détourne lâchement les yeux même si on peut juger qu’il ne fournit pas la bonne réponse. Si on refuse celle qu’il propose, encore faut-il en donner une autre … ».