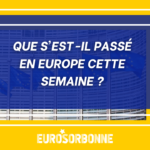Rappel massif de Coca-Cola en Europe : une contamination au chlorate en cause
Article écrit par Clarent GERARD
Depuis lundi 27 janvier, le groupe Coca-Cola fait face à une vague de rappels de certains de ses produits en Europe. Plusieurs lots de sodas commercialisés seraient contaminés par du chlorate, un résidu chimique qui peut présenter des risques pour la santé. L’entreprise a pris la décision de retirer ces produits du marché afin de prévenir tout danger pour les consommateurs. Cet incident « relance les débats sur la sécurité alimentaire et la rigueur des contrôles dans l’industrie agroalimentaire ».
Une alerte sanitaire d’ampleur
L’affaire a émergé après la détection de taux anormalement élevés de chlorate dans certains lots de boissons commercialisées par Coca-Cola en Europe. Le rappel concerne plusieurs pays, notamment la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Belgique. Ce composé chimique, utilisé principalement comme agent de désinfection de l’eau, peut devenir nocif à forte dose.
L’alerte a été lancée par des autorités sanitaires, qui, après vérification, ont détecté plusieurs lots présentant des concentrations de chlorate supérieures aux normes autorisées par l’Union européenne. En conséquence, Coca-Cola a dû se résoudre à un rappel massif, touchant potentiellement des millions de bouteilles et canettes.
Quels risques pour la santé ?
Le chlorate est un composé chimique qui peut affecter la santé humaine lorsqu’il est ingéré en quantité excessive. Il peut notamment engendrer des troubles hormonaux, en particulier chez les populations vulnérables comme les enfants et les femmes enceintes. L’institut national de recherche et de sécurité mentionne également un risque « d’intoxications aiguës graves, voire mortelles . Les autorités sanitaires rappellent que la consommation répétée de produits contaminés peut également avoir un effet néfaste sur les reins
Cependant, les experts rassurent sur le fait qu’une exposition ponctuelle à ces produits ne devrait pas entraîner de conséquences graves. C’est bien l’exposition prolongée et répétée qui pourrait poser problème. En attendant, les consommateurs sont appelés à être vigilants et à vérifier les lots concernés avant de consommer ces boissons.
La réaction de Coca-Cola et des autorités
Face à l’ampleur du scandale, Coca-Cola a pris des mesures rapides. L’entreprise a annoncé le retrait des produits incriminés et coopère avec les autorités pour éclaircir les raisons de cette contamination. Un porte-parole du groupe a indiqué que des investigations étaient en cours afin de déterminer l’origine du problème et d’éviter qu’il ne se reproduise à l’avenir. Les agences de sécurité alimentaire des différents pays européens suivent également l’affaire de près. En France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a émis des recommandations et mis en place une veille sanitaire sur les produits de la marque.
Un impact sur l’image de Coca-Cola ?
Cet incident pourrait avoir des répercussions sur l’image de la marque. Le groupe Coca-Cola est l’une des entreprises les plus massives du secteur agroalimentaire, et un scandale sanitaire de cette ampleur risquerait d’entacher la confiance des consommateurs. Ce n’est pas la première fois qu’un rappel de produits touche le groupe, mais l’ampleur européenne de cette alerte est ici inédite.
L’entreprise s’est déjà engagée à renforcer ses contrôles de qualité et à travailler en collaboration avec les organismes de régulation pour assurer la conformité de ses produits. Alors que les rappels se poursuivent, les consommateurs sont encouragés à se tenir informés des lots concernés et à éviter toute consommation des produits rappelés.
L’offensive de la milice M23 dans le Nord-Kivu : dernier acte de la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda
Article écrit par Gaspard RABIN
Lundi 27 janvier après à peine 24 heures de combat, Goma, la plus grande ville de l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), est tombée aux mains de la rébellion. Depuis le 23 janvier, l’armée congolaise s’oppose à l’avancée de milice M23, soutenue par le Rwanda, dans la région du Nord-Kivu. La prise de la ville a suscité de nombreuses réactions de la part de la communauté internationale, alors que la guerre en RDC est marquée par un regain de violences depuis maintenant trois ans.
Située à la frontière avec le Rwanda, la ville de Goma est contrôlée depuis lundi par la milice M23 et les forces rwandaises (FDR). Quelques poches de résistance ont persisté, notamment au niveau de l’aéroport durant quelques jours. Les FARDC (Forces armées de la République démocratique du Congo) et les wazalendo (milice de la région) ont rapidement été dépassés par l’offensive fulgurante sur la capitale de la province du Nord-Kivu. La ville de Sake, proche de Goma, avait déjà été victime d’une attaque de la part du M23 en février 2024. Si celle-ci avait échoué, elle avait permis à la milice d’évaluer les forces de résistance congolaises.
L’ambassade française à Kinshasa prise pour cible le 28 janvier 2025 – HARDY BOPE / AFP
Mardi 28 janvier, plusieurs ambassades à Kinshasa ont été violemment prises pour cible par des manifestations critiquant l’inaction de la communauté internationale. L’ambassade des Etats-Unis a été attaquée sans réel succès, celle de la France et de la Belgique ont été incendiées. Celles de l’Ouganda et du Rwanda ont été pillées, de même que le Centre Européen de délivrance des visas. Des coups de feu ont également été tirés dans la capitale de la RDC.
Risque d’escalade avec le Rwanda et de crise humanitaire
Jean-Noël Barrot, s’est rendu à Kinshasa et à Kigali le 30 et 31 janvier, et a demandé aux forces rwandaises de « quitter instantanément » le territoire de la République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie française a rencontré jeudi le président Félix Tshisekedi à Kinshasa avant de rencontrer celui du Rwanda, Paul Kagame, à Kigali. Il a rappelé l’importance du respect de la souveraineté territoriale de la RDC et a demandé au M23 de « se retirer immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle ». Les deux chefs d’Etat avaient déjà été réunis par Emmanuel Macron en 2022, afin de tenter de limiter la menace des milices dans l’Est du pays.
Les combats ont déjà fait des centaines de morts, civils et militaires, dont 5 casques bleus et 7 soldats sud-africains. L’inquiétude de l’urgence sanitaire règne alors que de nombreux corps sont laissés dans les rues. La ville de Goma est touchée par une panne d’électricité de grande envergure et est privée d’approvisionnement en eau. D’après les Nations Unies, 600 000 déplacés ont déjà été contraints de quitter leur foyer depuis le retour des affrontements en janvier.
L’implication de Kigali, et son soutien direct au groupe antigouvernemental M23 est largement documenté par les observateurs de l’ONU. La région est, depuis 2021, en proie à des tensions et de violents affrontements. Le rapprochement entre l’Ouganda et la RDC en 2021 a été perçu comme une menace par le Rwanda, qui a vu dans la région frontalière, la possibilité de se créer une « zone tampon ».
Friedrich Merz perd son pari sur l’immigration après une alliance avec l’extrême droite
Article écrit par Gaspard RABIN
À trois semaines des élections législatives du 23 février, Friedrich Merz, candidat CDU (chrétien-démocrates) à la chancellerie et favori des sondages, a échoué à faire adopter sa proposition de loi sur l’immigration, pourtant soutenu par le parti d’extrême droite Alternative fûr Deutschland (AfD). Critiqué par la gauche et le centre, il n’a pas su convaincre l’ensemble des députés de son propre camp vendredi 31 janvier.
En tête des sondages avec 30% des intentions de vote et dans le contexte de l’attaque au couteau du 22 janvier à Aschaffenburg, le chef de file de la CDU souhaitait marquer un coup de force en adoptant une proposition visant à restreindre l’immigration et le regroupement familial. Si le parti social-démocrate (SPD) de l’actuel chancelier Olaf Scholz et les Verts s’opposaient au texte, la majorité semblait acquise.
Mercredi 29 janvier était déjà un tournant historique pour la politique allemande. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Union chrétienne-démocrate a adopté une motion symbolique grâce à une alliance avec l’AfD au Bundestag. Jusqu’à présent, les formations historiques avaient toujours refusé l’alliance et les votes de l’extrême droite au nom du « cordon sanitaire ». Vendredi, la droite conservatrice a de nouveau voté de manière conjointe avec l’extrême droite, alors qu’il avait déclaré deux jours plus tôt regretter une telle majorité.
La proposition rejetée à 349 voix contre (et 328 pour)
Après une journée de débats houleux au Bundestag, le texte n’a finalement pas réussi à rassembler une majorité. L’alliance inédite de mercredi a suscité une vague de critiques alarmistes dans toute l’Allemagne, seulement quelques jours après la commémoration de la libération d’Auschwitz. Douze députés de la CDU et seize du Parti libéral-démocrate n’ont pas voté, fissurant alors le bloc des partis de droite.
L’ancienne chancelière Angela Merkel, elle aussi issue de la CDU, a vivement critiqué la position de Friedrich Marz et la coupure du « cordon sanitaire » remettant en doute sa « capacité à être chancelier ».
L’extrême droite triomphante
Friedrich Merz a nié vouloir faire alliance avec l’extrême droite et s’est défendu au contraire de vouloir la combattre en répondant aux demandes des allemands sur le thème de l’immigration, alors que l’AfD est crédité à 20% des intentions de vote.
Mais une semaine après l’intervention virtuelle d’Elon Musk au meeting de l’AfD, l’extrême droite allemande exulte. Après le vote de mercredi, le parti a revendiqué une « nouvelle ère » et peut maintenant compter sur cet épisode pour apparaître présentable un an après le scandale du projet de « remigration » qui avait secoué le pays et entraîné des manifestations massives contre le parti.
Cinq ans après le Brexit, un bilan mitigé ?
Article écrit par Clarent GERARD
Le 23 juin 2016, 51.89% des Britanniques votent en faveur du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Après plusieurs années de négociations et de tensions politiques internes, le Royaume-Uni quitte officiellement l’UE le 31 janvier 2020. Le 1er janvier 2021, après une période où le pays est resté au sein de l’union douanière et du marché unique européens, le Brexit entre pleinement en vigueur, marquant un tournant majeur dans l’histoire de l’Union européenne. Alors que ce 1er janvier 2021 marquait le début d’une nouvelle ère, le Brexit a laissé des traces profondes dans l’économie, les relations internationales et la vie quotidienne des Britanniques.
Cinq ans après, les conséquences semblent être toujours là, et le bilan demeure contrasté. Aujourd’hui, selon l’institut de sondage YouGov, seuls 30% des Britanniques seraient satisfaits du divorce avec Bruxelles.
Un choc économique et une crise des prix
Le premier impact visible du Brexit a été économique. En perdant l’accès au marché unique européen, le Royaume-Uni se voit fermer une porte qui permettait de commercer librement avec les 27 autres pays membres de l’UE. Le pays a subi une contraction économique significative, bien que les répercussions aient été accentuées par la pandémie de COVID-19. Certains secteurs ont été particulièrement touchés, notamment la pêche, l’automobile et l’agriculture, où les chaînes d’approvisionnement se sont fragilisées, et les entreprises britanniques ont fait face à une augmentation des coûts.
Les Britanniques ressentent aussi une inflation importante, notamment en raison des nouvelles barrières commerciales et de l’augmentation des coûts des importations. En 2023, la livre sterling, qui avait déjà chuté après le référendum de 2016, est restée vulnérable face aux autres grandes monnaies. Ce phénomène a amplifié la crise du coût de la vie, rendant les produits importés plus chers pour les consommateurs britanniques.
Néanmoins, l’attractivité financière reste stable : le Royaume-Uni est le pays attirant le plus d’IDE depuis 2014, et ce même depuis le Brexit.
Des frustrations persistantes et un débat sur l’identité
Au-delà de cet aspect économique, le Brexit a provoqué des bouleversements sociaux. Le Royaume-Uni a perdu une partie de son influence au sein de l’UE, ce qui a conduit à des débats sur la place du pays dans le monde européen.
“Aujourd’hui, nous avons la liberté de résoudre [les] problèmes nous-mêmes”, David Frost, négociateur pour la sortie de l’UE puis ministre du gouvernement de Boris Johnson de 2019 à 2021.
Si certains ont vu dans le Brexit une opportunité pour le pays de retrouver sa souveraineté, d’autres regrettent les liens forts avec l’UE et les avantages passés, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine qui force une reconnexion avec Bruxelles.
Les tensions internes sont encore palpables, surtout en Écosse, où une majorité avait voté pour rester dans l’UE. Le gouvernement écossais, dirigé par le Scottish National Party (SNP), a régulièrement exprimé sa volonté de refaire un référendum pour l’indépendance, estimant que le Brexit a fragilisé les liens avec le reste du Royaume-Uni. Les divergences entre les différentes régions du pays mettent en lumière un sentiment de fracture qui persiste.
Le Brexit a aussi mis à jour des questions identitaires complexes, notamment sur la question de l’immigration. La fin de la liberté de circulation entre le Royaume-Uni et l’UE a réduit l’arrivée de travailleurs européens, aggravant ainsi certaines pénuries dans des secteurs comme la santé, les transports et l’hôtellerie. Bien que l’immigration non-européenne ait augmenté, les Britanniques ont exprimé des frustrations sur l’impact social du Brexit, notamment sur les services publics.
Un regard sur l’avenir
Cinq ans après, le Royaume-Uni semble encore chercher son chemin post-Brexit. Si les partisans de la sortie de l’UE ont mis en avant la possibilité de négocier des accords commerciaux indépendants, les résultats concrets sont mitigés. Des accords ont été signés avec des pays comme le Japon, l’Australie et le Canada, mais l’impact global sur l’économie n’a pas compensé les pertes liées à la séparation d’avec l’UE. De plus, le Royaume-Uni continue de naviguer dans un contexte de faible croissance économique, de stagnation des investissements et de tensions sociales.
Cinq ans après le Brexit, le Royaume-Uni semble dans une phase de réévaluation de ses choix. Si le pays a retrouvé une certaine souveraineté politique, les conséquences économiques, sociales et diplomatiques restent préoccupantes. Les Britanniques, divisés, partagent désormais un sentiment ambivalent : à la fois désillusionnés par les difficultés rencontrées depuis la sortie de l’UE, et résolus à avancer sans l’Union.